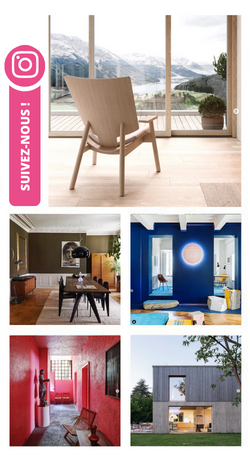Les bons critères pour choisir un isolant
Laine de verre et de pierre, perlite, graminées, chanvre, liège, laine… La multitude d’isolants existant sur le marché invite aujourd’hui à repenser les critères de sélection de ce type de matériau. Si les spécificités techniques couramment utilisées pour juger de leur qualité gardent leur légitimité, d’autres facteurs devraient devenir incontournables comme la protection contre la chaleur, l’influence sur la dégradation du bâti, le processus de fabrication ou le cycle de vie.

Isorigid d’Isover, le premier panneau isolant de sous-toiture en laine de verre pour toitures inclinées.
Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu’on choisit un isolant ? La réponse demande un peu d’attention car il n’y a pas d’isolant idéal. On ne va sans doute pas utiliser le même matériau de protection thermique partout. Cela dépend de la manière dont le bâtiment existant conduit, stocke et dissipe la chaleur et l’humidité. Comme on ne va pas utiliser le même isolant chez tout le monde. En effet, le choix d’un matériau dépend d’une hiérarchie de priorités à prendre en considération en fonction de préférences éthiques et budgétaires personnelles.
Avant d’opter entre un isolant organique ou minéral, peu ou très transformé, il convient donc de se poser les bonnes questions et évaluer posément ce qui nous convient le mieux. Les critères de sélection d’un isolant se doivent d’être larges en raison des connaissances dont on dispose aujourd’hui sur l’impact de ce type de matériau sur le bâtiment et son environnement.
N°1. La performance énergétique
Commençons par le critère le plus couramment utilisé pour juger de l’efficacité d’un isolant : la performance énergétique.
- L’efficacité thermique d’un isolant s’exprime par le coefficient de conductivité thermique (valeur lambda λ). Plus la conductivité est faible, plus l’isolant est performant.
- La résistance thermique (R) est une unité qui est associée à une couche de matériau caractérisée par une certaine épaisseur. Plus R est élevé, plus le produit est isolant.
Un isolant « efficace » limite les déperditions par transmission des parois. C’est grâce à cela qu’il permet de baisser la demande en énergie de chauffage en hiver et à mi saison.
Si vous choisissez de travailler essentiellement sur la performance énergétique, il sera par exemple légitime de choisir un polyuréthane ou une mousse résolique, deux matériaux hautement technologiques et performants. Mais d’autres options s’avèrent également très efficaces comme la laine de verre ou de roche.

Isolant en laine de verre Isover.
N°2. La protection contre la chaleur en été
L’inertie thermique renvoie à la capacité d’un élément à stocker et à restituer petit à petit de la chaleur avec un déphasage de temps. En hiver, cette propriété permet de stocker les gains solaires ; en été, elle évite les surchauffes.
L’inertie thermique est dépendante de la manière dont sont construits les murs d’un bâtiment, notamment leur densité. Ainsi, les murs en matériaux dits « lourds » (béton, pierre naturelle, briques…) offrent davantage d’inertie thermique.
La question de l’inertie est devenue stratégique avec le réchauffement climatique dans la mesure où de plus en plus de maisons sont exposées à des chaleurs de plus de 30° l’été. Or, la position de l’isolation, à l’intérieur ou à l’extérieur, va avoir un impact sur l’inertie du bâtiment. Dans le cas d’une isolation par l’intérieur, il est important de choisir un isolant capable de créer un grand déphasage de temps dans la restitution de la chaleur et ainsi, de limiter les surchauffes au sein des bâtiments. On reconnait ce type d’isolant aux indications suivantes :
- La masse volumique/densité (ρ). Plus (ρ) est élevé, plus l’inertie est importante.
- La capacité du matériau à emmagasiner la chaleur par rapport à son poids: chaleur spécifique (c). Une chaleur spécifique importante signifie qu’une grande quantité d’énergie peut être stockée, moyennant une augmentation relativement faible de la température.
Par exemple, si vous souhaitez isoler par l’intérieur un bâtiment, et que vous donnez la priorité à la protection contre la chaleur en été, l’option d’un isolant en fibres de bois dense peut-être un bon choix. En effet, la fibre de bois possède une chaleur spécifique (c) élevée.
N°3. Le comportement de l’isolant en présence d’humidité
Entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, il y a toujours d’importants échanges d’eau et de vapeur d’eau du fait des différences de température et d’humidité entre ces deux milieux. Or, une isolation mal pensée peut modifier sensiblement le comportement hygrothermique des parois et causer des pathologies importantes, comme des problèmes de condensation qui peuvent entraîner des dégradations à la fois matérielles et structurelles.
Ceci impose de comprendre le comportement du bâtiment existant et de savoir comment sont faites les parois. De la même façon qu’on le fait pour éviter les problèmes liés à l’inertie thermique.
Dans la construction neuve, la stratégie adoptée est souvent de couper tous risques d’humidité.
Dans les constructions plus anciennes, les murs sont parfois poreux et laissent par là migrer l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur. Lors du choix d’un isolant, il faut donc veiller à conserver cette capacité des murs à évacuer l’humidité, en particulier si vous isolez par l’intérieur. Il est nécessaire de s’assurer des capacités de séchage des murs et de l’évacuation de l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur.
Ainsi, si vous avez besoin d’isoler par l’intérieur des murs anciens, il peut être judicieux de se tourner vers un matériau isolant poreux ou fibreux qui a la capacité de contenir de l’humidité comme la laine de bois, la fibre de chanvre, de lin, coton, billes d’argile, perlite (roche volcanique) etc. Tout dépend de la manière est construite votre maison.

Isolant en chanvre Biofib.
N°4. Le renouvellement de l’air dans le bâtiment
On ne choisit pas un isolant en fonction de sa perméabilité à l’air et au vent: c’est l’affaire d’autres éléments du bâti comme les enduits de façade, les membranes, les panneaux, les huisseries de fenêtres etc.
Cependant, signalons ici l’erreur qui consiste à réaliser des travaux d’isolation et d’étanchéité à l’air sans penser au renouvellement de l’air intérieur du bâtiment. En effet, le renouvellement du dioxygène s’avère déterminant pour assurer une qualité d’air saine et propre, indispensable pour la santé.
N°5. Les autres propriétés techniques
Selon la situation du bâtiment, l’environnement dans lequel il se trouve et son usage, il peut être intéressant de prendre garde à la capacité d’isolation acoustique et la réaction au feu de l’isolant.
N°6. Les ressources nécessaires à la fabrication de l’isolant
Dans une perspective constructive frugale, économe en matières non renouvelables et en technologies, ont été lancés sur le marché des isolants à base de matières organiques qui poussent localement: des isolants en herbes. Présentant une efficacité très correcte (voir la valeur lambda λ et la résistance thermique R), ce type d’isolants séduit aujourd’hui les maîtres d’ouvrage qui souhaitent adopter un nouveau mode de vie et de consommation.

Panneaux isolants en fibres d'herbes Gramitherm.
N°7. Le processus de fabrication
La Suisse est un producteur de laine de roche, de laine de verre et de verre cellulaire. Des produits qui incluent, dans leur fabrication, la réintégration de leurs déchets dans le cycle de production. La laine de verre peut contenir jusqu’à 80% de verre recyclé, le verre cellulaire jusqu’à 70% de verre recyclé, la laine de roche jusqu’à 25% de briquettes recyclées.
D’autres matériaux présentent également un contenu élevé de matières recyclées comme la cellulose (jusqu’à 92% de papier recyclé) ou le coton recyclé.

Futuro de Flumroc, isolant en laine de roche fabriqués avec un liant naturel durable et sans adjonction de formaldéhyde.
N°8. Le cycle de vie l’isolant
Les enjeux climatiques imposent aujourd’hui de prendre en compte le cycle de vie d’un isolant. À ce chapitre, il faut savoir que certaines filières sont aujourd’hui organisées pour récupérer d’anciens isolants et les réintégrer dans le processus de production. D’autres isolants, les biosourcés, sont en grande partie biodégradables à partir du moment où l’on crée des conditions spécifiques (chaleur, humidité…) pour leur dégradation.
POUR EN SAVOIR PLUS, NOTRE CONSEIL DE LECTURE :
Sophie Trachte et Dorothée Stiernon sont les auteures de l’ouvrage « Isolations thermiques en rénovation » aux éditions EPFL PRESS. Issu de leurs recherches, ce condensé d’informations (276 pages) offre une analyse comparative – établie selon des critères techniques, environnementaux et circulaires – d’une cinquantaine d’isolants thermiques actuellement disponibles sur le marché.
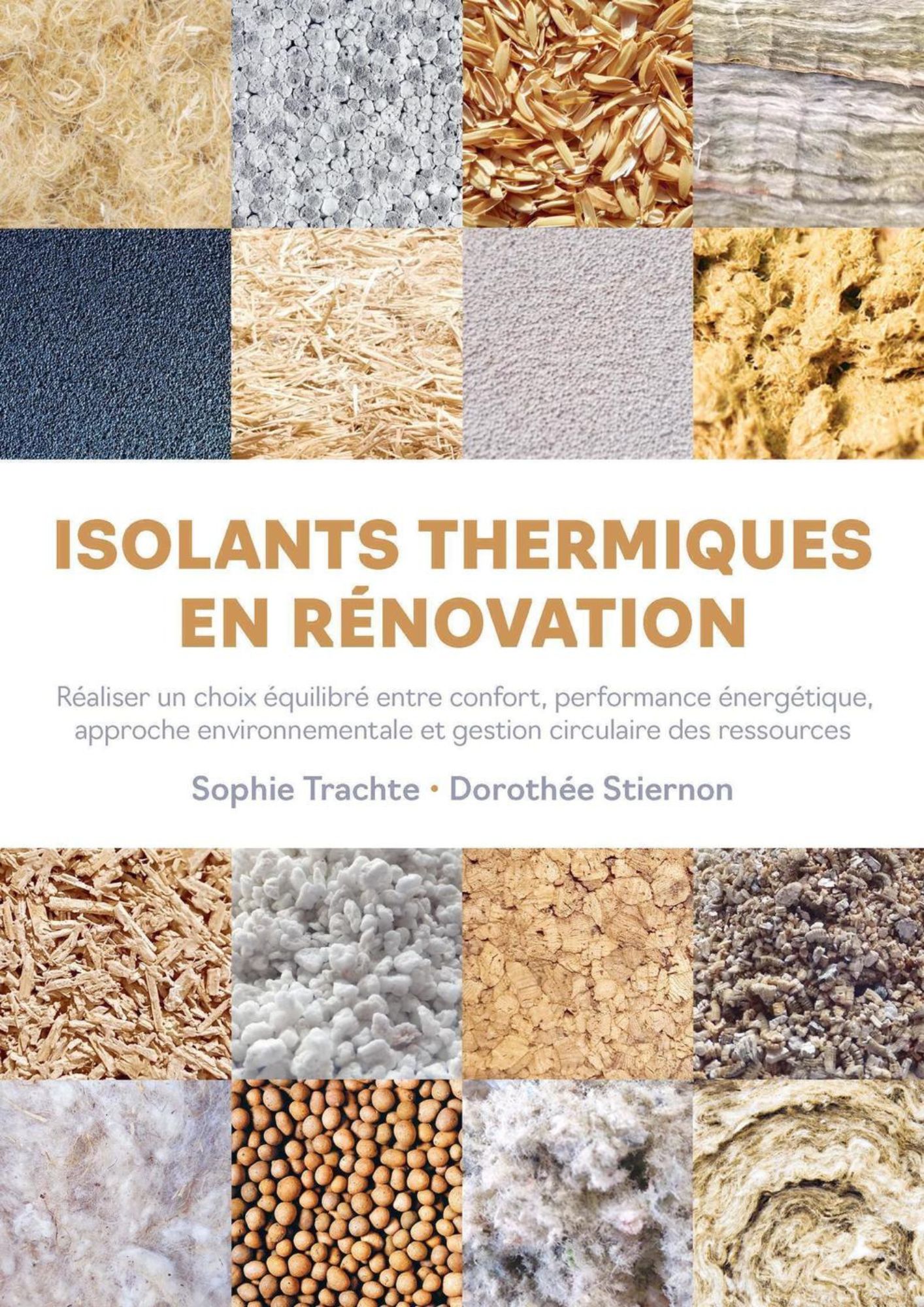
Isolations thermiques en rénovation, Sophie Trachte et Dorothée Stiernon, EPFL PRESS.