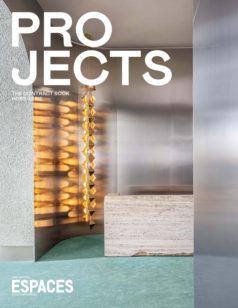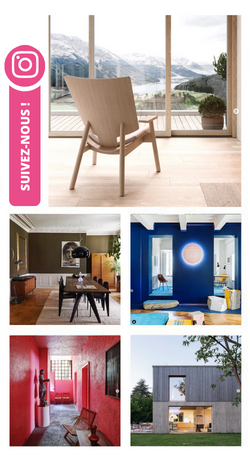Yotam Ottolenghi: la cuisine comme langage
Chef, auteur et conteur culinaire, Yotam Ottolenghi a fait de la cuisine un langage universel, nourri de croisements culturels, de collaborations et de récits personnels. Dans cet entretien, il revient sur la manière dont les plats racontent des histoires, créent du lien — mais peuvent aussi cristalliser des tensions — et sur l’équilibre subtil entre influences, identité et création collective qui façonne sa signature culinaire.

Portrait Yotam Ottolenghi
Vous évoquez souvent la manière dont la cuisine rassemble les gens. Pouvez-vous m’en dire plus sur votre vision de la cuisine comme vecteur de récit et de lien, et sur le fait qu’elle puisse aussi être source de division ?
Absolument, la cuisine peut faire les deux. Comme toute activité humaine, elle peut créer des ponts, mais aussi des tensions. Ces dernières années, je me suis beaucoup interrogé sur la question de l’emprunt culturel, sur la légitimité qu’il y a à relier différentes traditions à travers une recette. Nous sommes aujourd’hui plus sensibles à la manière dont les cultures se mêlent, s’influencent ou se réinterprètent. La cuisine dite «fusion» existe depuis des décennies, mais, en réalité, les échanges culinaires sont aussi anciens que l’humanité. Nous avons toujours échangé des idées, des recettes, des ingrédients — parfois dans l’harmonie, parfois à travers les conflits. La cuisine reflète la complexité de toute interaction humaine. J’ai récemment lu The Silk Roads de Peter Frankopan, qui retrace l’histoire des échanges entre Orient et Occident. Cela rappelle à quel point l’influence entre les cultures est millénaire.
Pour moi, tout se joue dans le récit. Quand je crée un nouveau plat, j’essaie d’être le plus honnête possible sur les influences qui le nourrissent — ce qui m’a inspiré et les traditions sur lesquelles il repose. J’ai récemment écrit un article pour le New York Times à propos d’un couscous qui forme une croûte au fond de la casserole, un peu comme le riz dans les traditions persane, espagnole ou coréenne. Je le termine avec
du poisson, sur lequel je verse une huile chaude et épicée pour rendre la peau croustillante — une technique inspirée des cuisines asiatiques. Sans l’avoir prémédité, je me suis retrouvé à tisser plusieurs cultures
dans un seul plat. C’est ce que je trouve magique dans la cuisine: elle repose sur d’innombrables échanges, conscients ou non.
Quand vous créez un plat, est-ce pour vous une manière de dire quelque chose, ou plutôt d’écouter vos influences, vos collaborateurs, vos convives ?
C’est un peu des deux. Je crée des plats pour différentes raisons, dans des contextes variés. Lorsqu’on élabore un menu de restaurant, il doit remplir plusieurs fonctions : plaire aux végétariens et aux véganes,
paraître frais et vivant, et refléter une diversité de styles et de saveurs. Avec une vingtaine de plats à la carte, chacun doit exprimer quelque chose d’essentiel de notre cuisine. Mais quand je crée une recette pour
une publication, c’est beaucoup plus personnel. Si c’est la saison des asperges au Royaume-Uni, par exemple, je ressens une joie instinctive et j’ai envie de la partager, de raconter ce que je cuisine quand les premières
asperges arrivent, en avril ou mai. Chaque projet a sa propre motivation.

Ottolenghi Marylebone
Le processus est-il très différent entre la création d’un plat pour un restaurant et celle d’une recette pour un livre ?
Oui, ce sont deux processus assez distincts. Je travaille toujours en équipe — je ne peux pas revendiquer chaque plat du menu. Neil Campbell, notre chef exécutif, collabore étroitement avec les chefs de chaque établissement, comme Maxime (Martin) ici à Ottolenghi Genève, au Mandarin Oriental, Geneva. Parfois, un plat naît à Rovi, à Londres, et Maxime l’adapte ensuite selon les produits disponibles sur place. La logistique, les ingrédients locaux et la créativité de l’équipe influencent énormément le résultat. C’est un processus collectif et complexe. Pour les livres, la plupart du développement se fait dans notre cuisine d’essai. C’est là que je passe une grande partie de mon temps créatif. Tout ce que j’écris pour The Guardian, le New York Times ou ma newsletter Substack naît dans cet espace. Les restaurants, eux, ont leur propre rythme créatif. Je supervise les menus, mais je ne les dicte pas.
La collaboration semble occuper une place importante dans votre travail. Comment choisissez-vous vos collaborateurs ?
Historiquement, beaucoup de personnes qui ont intégré notre cuisine d’essai venaient de l’entreprise. Elles avaient pu travailler dans l’un de nos restaurants ou de nos delis avant de rejoindre l’équipe de création. Des gens comme Ixta Belfrage ou Helen Goh ont suivi ce parcours. Ce que je recherche, c’est un regard — pas seulement une compétence technique, mais une manière de penser la cuisine qui m’inspire. On apprend les uns des autres, et cet échange est au cœur de notre travail.

Produits et livres Ottolenghi
Malgré toutes ces collaborations, vos recettes gardent une identité ottolenghi très marquée. Comment maintenez-vous cette signature tout en intégrant sans cesse de nouvelles influences ?
C’est la question que je me pose tous les jours : « Est-ce assez Ottolenghi ? » Il n’y a pas de formule, mais il y a des principes. Nous cherchons toujours une forme d’innovation, un angle singulier — parfois une épice utilisée de manière inattendue, parfois une présentation originale d’un ingrédient familier. Dans Simple, par exemple, je voulais revenir à l’essentiel — rendre les recettes plus accessibles sans en perdre la personnalité. Certains plats peuvent sembler traditionnels à première vue, mais ils appartiennent à l’univers Ottolenghi parce qu’ils partagent ce mélange de générosité et d’audace. Une autre caractéristique, c’est la superposition — des saveurs, des textures, des présentations. Nos plats se construisent souvent par strates : une base, un élément central, une garniture. Quand on y goûte, on ressent à la fois le contraste et la complexité. Mais au cœur de chaque plat, l’ingrédient doit rester reconnaissable — un chou-fleur doit ressembler à un chou-fleur et en avoir le goût. Je ne cherche pas à dissimuler les aliments : je veux voir ce que je mange.
À quel moment du processus intervient le visuel, la présentation, le design du plat ?
Parfois dès le départ. On se moque souvent de moi parce que je pense aux assiettes avant même d’avoir cuisiné. Mais le visuel fait partie intégrante de la création, un contraste de couleur, une forme, une composition. L’inspiration peut venir de n’importe où : une photo, un motif, ou même une erreur. Un jour, j’ai aperçu une image qui ressemblait à des pommes de terre en spirale et je me suis dit : « Tiens, c’est intéressant », avant de réaliser que ce n’en était pas. Mais cette image a déclenché une idée de plat et de présentation.
Comment trouvez-vous l’équilibre entre l’instinct et l’intention ?
Je me laisse guider par ce que le plat me dicte. Parfois le plan fonctionne, parfois c’est l’instinct qui prend le dessus. Récemment, je travaillais sur une recette de poulet grillé accompagné de haricots beurre. L’idée était de cuire les haricots dans le jus du poulet pour qu’ils s’en imprègnent. Au début, ça ne marchait pas, la peau du poulet ne devenait pas croustillante. En réduisant la quantité de liquide, les haricots sur les bords ont caramélisé et sont devenus croustillants. Ce contraste accidentel a transformé le plat. Ces surprises-là sont les plus belles.

Ottolenghi Genève

Yotam Ottolenghi en séance de dédicace de son livre Simple.